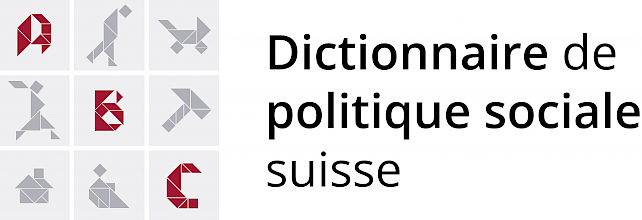Austérité
Version originale en italien
Ce qu’on appelle les « mesures d’austérité » prévoit l’« examen des dépenses publiques » (spending review) pour « optimiser » les services publics, une réduction des dépenses sociales, comme celles de retraite, de santé et d’assistance et l’augmentation de la pression fiscale sur les contribuables. Des conséquences fréquentes des politiques d’austérité sont l’augmentation du chômage, la récession ou encore la baisse de la consommation. En provoquant un ralentissement de la croissance économique, ou sa stagnation, les mesures d’austérité peuvent entraîner une réduction des recettes fiscales et donc, par un curieux paradoxe, une augmentation de la dette publique au lieu de sa réduction, qui est pourtant la raison d’être des politiques d’austérité.
Les politiques d’austérité s’inscrivent le plus souvent dans le cadre des politiques économiques et fiscales néolibérales qui se sont affirmées dès le début des années 1980 avec l’élection de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis. Ce tournant néolibéral s’accompagnait de la volonté de créer les conditions nécessaires à un profond remaniement de l’État social au profit de la primauté du marché, en s’appuyant sur le principe de la capacité des marchés à s’autoréguler. Pour ce faire, la stratégie mise en œuvre a été celle des caisses vides ou de l’État pauvre, résumée par David Stockman, conseiller économique de Ronald Reagan, dans la formule starving the beast, à savoir vider les caisses de l’État par des mesures de défiscalisation des revenus élevés et des profits, de manière à contraindre les politicien·ne·s à adopter des mesures de réduction des dépenses. Selon cette théorie, les disponibilités libérées par la réduction de la pression fiscale devaient se traduire par une augmentation des investissements, de l’emploi et de la consommation. En réalité, cette stratégie a contribué à alimenter la financiarisation naissante, à savoir le détournement de l’épargne vers les marchés financiers et non pas vers les activités de production. Dès les années 1990, la Suisse au même titre que d’autres États européens a été influencée par ces politiques néolibérales, comme l’ont par exemple montré les travaux de Sébastien Guex.
Pour se déployer pleinement, selon les intentions de leurs partisan·e·s théorico-politicien·ne·s, les mesures d’austérité nécessitent la création d’un contexte d’urgence susceptible de contourner le processus démocratique normal et le consensus nécessaire pour les mettre en pratique. En Suisse, l’instrument du frein à l’endettement peut être interprété de cette façon. Au-delà du cas de la Suisse, la crise de 2008, qui a vu le jour aux États-Unis et s’est propagée en Europe, a été l’occasion de transformer les mesures d’austérité en véritables interventions (voir Troïka ci-dessous), rendues inévitables en raison de l’état d’urgence créé par la crise et soutenues par des traités internationaux comme le fiscal compact. Durant cette crise, les États ont porté secours au système bancaire par des aides massives. En augmentant ainsi fortement la dette publique, ils se sont exposés aux marchés financiers et à leur discipline par la vente de leur dette aux investisseur·e·s privé·e·s, créant une raison supplémentaire de réduire les dépenses publiques, sociales en particulier. Ces circonstances ont fait émerger les conditions pour la réalisation de ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc, une situation d’urgence qui autorise l’adoption de mesures sociales de réduction des droits démocratiques et sociaux qui, autrement, ne seraient pas réalisables politiquement. « Nous avons tous vécu au-dessus de nos moyens », « l’État est au bord de la faillite », « les retraites et le système de santé ont atteint des sommets insoutenables », « nous ne devons pas faire peser sur nos petits-enfants la dette publique que nous avons créée » : tels sont les arguments avancés pour justifier les mesures d’austérité, alors même qu’elles ne sont ni scientifiquement étayées ni légitimées par des procédures démocratiques.
N’appartenant pas à l’Union européenne et à la zone euro, la Suisse subit les effets des mesures d’austérité européennes à travers une forte pression sur le franc, considéré comme une monnaie refuge. En effet, les mesures d’austérité appliquées dans les pays membres de l’UE ont contribué à la persistance de la récession qui a suivi la crise de 2008. Avec la diminution de la demande et de la consommation, les dettes publiques des États membres n’ont pas diminué, amorçant dans certains cas un cercle vicieux de réduction des dépenses publiques pour satisfaire les directives de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international). Le climat d’incertitude planant sur la tenue de l’euro a maintenu à un niveau élevé la tension sur les marchés monétaires et sur le franc en particulier. Cela en contraignant, dans un premier temps, la Banque nationale suisse (BNS) à défendre un taux de change minimum entre le franc et l’euro puis, dans un deuxième temps en 2014, à l’abandonner, afin d’éviter l’injection excessive de francs visant à défendre cette parité. L’augmentation de la quantité de francs en circulation, d’une part, et la réévaluation du franc, d’autre part, sont à l’origine d’une pression sur les conditions salariales et de l’emploi dans l’industrie d’exportation. Ainsi, les mesures d’austérité mises en œuvre en Europe à partir de 2010 ont été importées en Suisse. Elles ont toutefois été précédées par des mesures visant à assainir les bilans des assurances sociales, très sollicitées au terme de la crise des années 1990, au cours desquelles la Suisse a connu un taux de chômage élevé et le recours à l’assurance-invalidité (AI) a joué le rôle d’amortisseur social. Les révisions de l’AI et de l’assurance-chômage (AC) peuvent être interprétées comme les équivalents des mesures d’austérité inscrites dans les politiques libérales du « moins d’État ». Les réductions de budget des assurances sociales se sont, à leur tour, répercutées à l’échelle cantonale avec l’augmentation des dépenses d’aide sociale.
Pour sortir de la grande récession sans remettre en cause la pertinence des politiques budgétaires restrictives, la Banque centrale européenne (BCE) a eu recours à des politiques monétaires expansives. Le quantitative easing (assouplissement quantitatif monétaire), dans le cadre duquel la BCE acquiert des titres publics et privés avec une injection mensuelle massive de liquidités, a pour objectif de relancer le crédit aux entreprises et aux familles et, par conséquent, de favoriser la reprise de l’économie et de l’emploi. Aux yeux de ses détracteur·trice·s, cette stratégie de politique monétaire a surtout servi à alimenter les marchés financiers sans avoir de retombées positives sur l’économie réelle, ni atteindre les objectifs souhaités. Pour la Suisse, le quantitative easing a contraint la BNS à continuer de défendre discrètement le franc par l’injection de liquidités destinées à l’achat d’euros et à engager une politique de taux d’intérêt négatifs pour contrecarrer la pression sur le franc. Compte tenu de la configuration du système des assurances sociales qui, au cours de la dernière décennie, ont investi une grande partie de leurs réserves dans les marchés financiers, les taux d’intérêt négatifs ont d’importantes conséquences sur leur capacité d’assumer leurs engagements, notamment en ce qui concerne les trois piliers du système de retraite. Par contraste, les politiques monétaires restrictives que certaines banques centrales, dont en tout premier lieu la Federal Reserve, ont adoptées à partir de 2016, laissent entrevoir une augmentation généralisée des taux d’intérêt. On parle du passage du quantitative easing au quantitative tightening. Cette nouvelle dynamique, après des années de taux d’intérêt négatifs, peut entraîner une dévaluation des obligations détenues par de grands investisseurs comme les fonds de pension et le Fonds de compensation de l’AVS. Avec des taux d’intérêt en hausse et, par suite, la réduction de la valeur des titres, les liquidités du système de prévoyance vont diminuer, mettant en danger la capacité de verser les rentes. Pour juguler ce risque, le défi consiste à intervenir sur les entrées, en créant des emplois et en augmentant l’assiette des cotisations, et par conséquent les revenus. Cela signifie toutefois qu’il faut identifier de nouvelles sources de financement dans une économie de plus en plus numérisée, en envisageant, par exemple, une taxe sur les robots ou la fiscalisation de la part de profit résultant de la masse d’informations produites par les utilisatrices et utilisateurs des plateformes numériques.
Références
Gallino, L. (2015). Il denaro, il debito e la doppia crisi. Torino : Einaudi.Guex, S. (1998). L’argent de l’État : parcours des finances publiques au XXe siècle. Lausanne : Réalités sociales.
Varoufakis, Y. (2017). Et les faibles subissent ce qu’ils doivent ? Comment l’Europe de l’austérité menace la stabilité du monde. Paris : Babel.