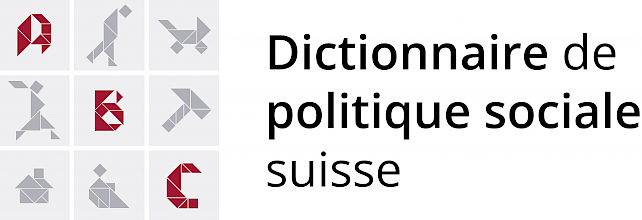Délinquance juvénile
Version originale en allemand
Le terme de délinquance juvénile repose sur l’idée que les jeunes délinquants n’ont pas encore achevé de construire leur personnalité et qu’ils ne peuvent donc pas être tenus responsables de leurs actes de la même façon que les adultes. D’après des recherches sur la criminalité cachée, les délits relevant du droit pénal sont très répandus chez les jeunes (surtout les délits mineurs). Les actes sont souvent commis spontanément, en groupe, et les dommages économiques sont la plupart du temps négligeables. À l’approche de la majorité, les comportements répréhensibles diminuent sensiblement, et sans intervention pénale. La délinquance juvénile se caractérise par trois éléments : l’ubiquité (omniprésence), le recul des délits vers la fin de la jeunesse même sans intervention et la moindre gravité. Seul un petit groupe (environ 6 % des jeunes dans cette tranche d’âge) commet des délits nombreux et graves sur une période prolongée. C’est ce groupe qui est considéré comme problématique et à risque par la politique de lutte contre la criminalité (dans les pays anglo-saxons, on les appelle les chronics, high risk offenders ou persistent offenders). Ce groupe cumule souvent divers facteurs de risques sociaux, culturels, psychologiques (difficultés d’apprentissage) ou biologiques/neurologiques. La question de savoir lesquels des nombreux facteurs d’influence imaginables déterminent le comportement conforme ou déviant des jeunes ne fait pas l’unanimité.
La position particulière des enfants et des jeunes au regard du droit est un acquis récent. Au Moyen-Âge, le droit pénal s’appliquait encore de la même façon aux enfants et aux adultes. Parallèlement à l’humanisation du droit pénal au début du siècle des Lumières, au développement de la peine moderne de privation de liberté, au recul de la peine capitale et des châtiments corporels et à la création de pénitenciers sont apparues les premières institutions avec prétention pédagogique pour les « enfants mal élevés ». Le développement d’une juridiction moderne (destinée aux jeunes) a connu une avancée décisive lorsque Franz von Liszt a réclamé que les interventions de droit pénal s’attachent non pas aux faits et à leur répression, mais plutôt à la personnalité du coupable et aux possibilités de resocialisation éducative.
En Suisse, l’idée d’une justice des mineur·e·s est née à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1920 et 1930, plusieurs cantons ont adapté leur législation aux réformes éducatives. Le Code pénal suisse de 1942 a finalement remplacé les législations cantonales. Les articles 82 à 99 formulent les grandes lignes d’un droit pénal axé sur la faute, mais à vocation éducative. Il exige qu’en cas de négligence ou d’atteinte (à la moralité), des mesures soient d’abord prononcées.
Depuis les années 1960 et 1970, divers programmes de réforme ont changé durablement la perception du phénomène de « criminalité juvénile » sur la scène internationale. On a commencé à remettre en question les objectifs officiels de la peine : celle-ci n’aurait qu’un effet dissuasif relatif et la probabilité de nouveaux délits ne diminuerait pas avec la sévérité de la sanction pénale, au contraire; de plus les comportements délinquants seraient abandonnés à l’entrée dans l’âge adulte, la plupart du temps sans intervention. On a donc préconisé une action plus éducative que répressive et proposé de contenir le plus possible les influences stigmatisantes de la juridiction pénale officielle. Il fallait renoncer aux poursuites pénales pour les infractions mineures ou de gravité moyenne, et s’efforcer davantage de resocialiser le délinquant. Dans le jargon juridique, on utilise le terme « diversion » pour désigner le détournement des procédures pénales officielles.
À peu près au même moment, des mouvements d’aide aux victimes exigeaient que l’on accorde davantage d’attention à l’indemnisation qu’à la peine. Plutôt que de constater la faute (en pointant du doigt le délinquant), la justice compensatrice (restorative justice) se concentre sur la constatation du dommage (en mettant l’accent sur la partie lésée). Depuis, l’idée d’indemnisation est présente dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux, mais n’a souvent qu’une portée limitée dans la justice des mineur·e·s.
La « criminalité juvénile » n’existe donc pas comme un fait établi. Elle est davantage conditionnée par ce que la société définit comme normes incontournables et frontières morales, par les moyens qu’elle utilise pour réagir aux violations des normes et par la manière dont elle tient compte de la situation de chaque jeune.
Depuis 2007, la Suisse connaît un Droit pénal des mineur·e·s à part entière. Il s’articule autour de deux formes de réaction : les peines et les mesures de protection. Il applique le principe « éduquer avant de punir ». Les réactions doivent être adaptées à la situation personnelle du délinquant ou la délinquante et favoriser le développement de sa personnalité de manière positive. Les peines ne sont pas vues comme des représailles, mais comme un avertissement censé déclencher des processus d’apprentissage. Les peines et mesures éducatives peuvent être formulées simultanément ou se remplacer lors de leur application (remplacement de sanctions pénales ou système dualiste vicariant respectivement). Le coût de l’application des mesures de protection est supporté par les cantons ; les parents et les jeunes ont une obligation de contribution.
Dans le droit pénal suisse des mineur·e·s, les menaces de sanction sont bien moins sévères que dans les autres pays d’Europe. Les mesures pénales de placement telles que la privation de liberté ou la détention provisoire ou de sécurité sont rarement prononcées. Qui plus est, elles ont encore diminué depuis le début des années 2010. Dans le Droit pénal des mineur·e·s, l’essentiel des mesures interventionnistes est surtout mis en œuvre dans une optique de protection (surveillance, suivi personnalisé, traitement ambulatoire, placement en milieu ouvert ou fermé), tandis que les « peines » (hors peines privatives de liberté) sont plutôt appliquées aux délits mineurs (avertissement, travail personnel, amende).
Le système suisse se distingue également par les compétences attribuées au ministère public des mineur·e·s (Suisse alémanique) ou aux juges pour mineur·e·s (Suisse romande et Tessin). Il s’agit d’autorités d’instruction, d’accusation ainsi que d’exécution et elles ont un pouvoir décisionnel sur la plupart des sanctions.
Les avantages du système pénal suisse pour mineur·e·s s’observent surtout dans sa souplesse et l’examen au cas par cas. Ses possibles inconvénients résident dans le fait qu’il manque souvent au personnel judiciaire l’expérience professionnelle pour juger des mesures d’éducation et dans la faiblesse des conditions-cadres fixées pour l’établissement et l’évaluation des sanctions. Comme le taux de récidive est plutôt faible en Suisse en comparaison internationale, le système pénal des mineurs du pays a généralement bonne presse.
Si le nombre de jeunes délinquant·e·s jugé·e·s en Suisse a augmenté entre 1999 et 2009, les chiffres ne cessent de reculer depuis 2010. Les principes de prévention et d’intervention à visée éducative semblent donc agir sur les comportements déviants. L’identification précoce des groupes à risque et le développement des réactions appropriées face aux délinquants récidivistes constituent d’autres défis de taille. Par ailleurs, avec la médiatisation croissante des sphères de vie, on voit apparaître de nouvelles formes de déviance telles que le cyberbullying (diffamation ou harcèlement par des moyens de communication numériques) ou le sexting (diffusion de photos intimes par des moyens de communication numériques), contre lesquelles il reste encore à définir des réactions appropriées.