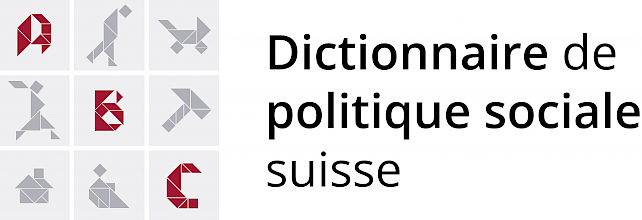Corporatisme
Version originale en allemand
Le corporatisme suisse est né au XIXe siècle. À cette époque, l’État fédéral suisse avait besoin de statistiques pour bien fonctionner, mais manquait des compétences et des ressources nécessaires pour les obtenir lui-même. Il a dès lors financé le secrétariat de l’Union suisse du commerce et de l’industrie (Vorort) afin que celui-ci recueille et traite ces données pour son compte. De même, il a financé les secrétariats de l’Union des arts et métiers, des syndicats et de la fédération paysanne en échange de services. L’État a poursuivi ce fonctionnement jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est entre la Première Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale que l’intégration des groupements d’intérêts au sein de l’État suisse a pris son essor. À cet égard, la paix du travail conclue en 1937 entre les syndicats et le patronat afin de chercher une autre manière que la grève pour mener des négociations collectives est une étape importante. Ce processus d’intégration s’est vu couronner par les articles relatifs à l’économie ajoutés à la Constitution suisse en 1947. Les groupements d’intérêts avaient désormais le droit d’être consultés par l’État qui, de son côté, pouvait compter sur eux pour la mise en œuvre de ses politiques. Cette position de force des groupements d’intérêts est restée incontestée jusque dans les années 1980. Par la suite, leurs chances d’influencer les politiques ont commencé à s’amoindrir : les changements sociétaux et économiques en cours leur posaient des problèmes d’organisation. Les syndicats subissaient les conséquences de la désintégration des structures socioculturelles, de l’évolution de la société industrielle vers une société de services et de la tendance croissante à l’individualisme. Les travailleur·euse·s industriel·le·s traditionnel·le·s, avec leur attitude fondamentalement positive à l’égard de l’auto-organisation syndicale, ont largement disparu. Les nouveaux emplois dans le secteur des services privés ont été difficiles à organiser pour les syndicats et l’érosion de la conscience d’un destin collectif, en tant que salarié·e, a ébranlé la volonté d’adhésion aux associations. Les organisations d’employeur·euse·s ont été confrontées aux conséquences de l’internationalisation des marchés des capitaux et des biens. Les intérêts nationaux ont moins été pris en compte et la volonté de parvenir à un équilibre et à un compromis entre les secteurs économiques s’est émoussée. Les organisations d’employeur·euse·s ne pouvaient ainsi plus compter sur la même volonté de suivre le mouvement des chef·fe·s d’entreprise, qui ont davantage opté pour un lobbying spécifique à l’entreprise. La littérature fait également état du processus d’européanisation, qui a de plus en plus transféré les décisions du domaine préparlementaire au domaine parlementaire et qui a partiellement dissous un bastion de l’influence associative : les commissions préparlementaires avec une forte représentation des groupes d’intérêts. Il y a eu en outre une politique budgétaire prudente, qui a réduit la marge de manœuvre politique dans les cycles de négociations entre l’État et les associations, ainsi qu’une plus grande transparence du processus politique grâce aux critiques des médias, ce qui a entravé les négociations et compromis confidentiels entre les acteur·trice·s à huis clos. De nombreuses réalisations ont été attribuées au corporatisme suisse. Citons notamment la large absence de conflits de travail ouverts, les bons rapports des entreprises avec leur main-d’œuvre et la tentative de créer le plein emploi pour les travailleur·euse·s suisses. Les critiques ont attiré l’attention sur les rigidités institutionnelles et l’hostilité aux réformes du système corporatiste.
La recherche établit une distinction entre le corporatisme libéral et le corporatisme social. L’État a un rôle important à jouer dans le corporatisme social, par exemple en compensant les associations collaborantes par des politiques fiscales et sociales. Les syndicats sont ici égaux, voire supérieurs aux organisations patronales en termes d’influence. L’Autriche est un parfait exemple de corporatisme social. Le corporatisme libéral, quant à lui, se caractérise par des associations patronales fortes et un État discret qui s’abstient largement de toute compensation sociale. Les syndicats sont pour ainsi dire des « partenaires juniors ». C’est le cas en Suisse. Le corporatisme a connu de graves crises dans de nombreux pays depuis le milieu des années 1970 et a été au moins temporairement abandonné, il est resté cependant relativement fort en Suisse, malgré une perte d’influence marquée. L’une des principales raisons en est la démocratie directe, qui garantit aux groupes d’intérêts « aptes au référendum » de grandes possibilités d’influence, même si leur base de membres diminue. Tandis que le corporatisme social était particulièrement actif dans le domaine de la gestion macroéconomique et de la politique sociale et fiscale, le corporatisme libéral suisse se concentre sur la coopération associative dans des domaines plus éloignés des questions de redistribution, tels que la formation professionnelle.
Un défi important pour le corporatisme suisse n’est pas seulement l’érosion déjà évoquée de sa base socioculturelle. Les relations étroites entre les partis politiques et les associations en matière de programmes et de liens personnels ont constitué une ressource importante du système de négociation. La social-démocratie, en tant que partenaire historique des syndicats de l’Union syndicale suisse, a assoupli ses liens avec les associations de travailleur·euse·s afin d’attirer de nouveaux groupes d’électeur·tice·s au-delà du monde ouvrier classique, tandis que les classes sociales inférieures votent de manière disproportionnée pour l’Union Démocratique du Centre. Enfin, la polarisation du système de partis ébranle non seulement les coalitions entre l’économie et les partis bourgeois, mais aussi la capacité de fonctionnement du corporatisme en tant que deuxième système de négociation central de la Suisse, à côté de la concordance qui est tout autant menacée.
Références
Armingeon, K. (2011). A prematurely announced death ? Swiss corporatism in comparative perspective. In C. Trampusch & A. Mach (Eds.), Switzerland in Europe : continuity and change in the Swiss political economy (pp. 165 – 185). London : Routledge.Gruner, E. (1959). Der Einbau der organisierten Interessen in den Staat. Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 95, 59-79.
Sciarini, P., Fischer, M. & Traber, D. (Eds.) (2015). Political decision-making in Switzerland : the consensus model under pressure. London : Palgrave Macmillan.