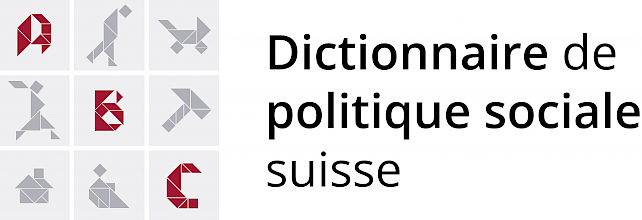Écologie
Dès les débuts de l’industrialisation, les « dégâts du progrès » affectent les populations, surtout ouvrières, et les milieux, urbains notamment. La socialisation des risques amenée par les premières politiques sociales est concomitante des mesures de police visant à réguler les « externalités » de la production économique, comme la pollution de l’air ou de l’eau. Ces régulations sont moins des limites mises à la libre initiative des acteurs capitalistes de l’économie que des mesures permettant de faire accepter aux populations les nouveaux risques industriels. Les années 1970 ne marquent dès lors pas un tournant radical qui se caractériserait par une « prise de conscience écologique » nouvelle. Par contre, les trente ou quarante dernières années voient les préoccupations écologiques se globaliser (climat, biodiversité, etc.). Au cours de cette période plus récente, trois grandes visions de l’écologie – et de ses rapports à la politique sociale – peuvent être distinguées : l’écologie néomalthusienne, l’écologie libérale et l’écologie sociale.
Très présent dans les années 1970, le néomalthusianisme américain et européen a surtout proposé des politiques sociales visant à limiter, voire à réduire, la taille de la population mondiale, à commencer par celle des pays du Sud. Craignant que la « surpopulation » mondiale, la « Bombe P » du biologiste Paul Ehrlich, ne vienne détruire les ressources naturelles, épuiser les sols et polluer la planète, les néomalthusiens demandent des mesures drastiques. Parfois en appui des mouvements féministes, certains encouragent le planning familial, l’avortement et la contraception. La plupart, toutefois, se montrent coercitifs, demandant que les gouvernements, notamment dans les pays du Sud, interdisent les naissances multiples par des campagnes de stérilisation, ou en amendant les familles trop nombreuses. Quelques-uns s’affichent ouvertement comme eugénistes (le biologiste Garett Hardin, théoricien de la « tragédie des communs ») et suggèrent des politiques d’amélioration génétique de la population et de limitation des migrations internationales au nom de la protection de la « qualité de vie ». Cette vision de l’écologie promeut ainsi une conception de la politique sociale qui ne vise pas prioritairement l’expansion des droits sociaux et l’amélioration du niveau de vie, mais la limitation des populations susceptibles d’en bénéficier.
Pour les écologistes libéraux, le marché peut réguler parfaitement les contraintes écologiques, à condition de distribuer correctement les droits de propriétés sur les ressources et l’environnement. Basée sur le principe du pollueur-payeur, leur politique consiste, dès les années 1970, à mettre un prix sur la nature. Ainsi l’introduction de taxes écologiques sur la consommation vise à modifier le comportement des individus en renchérissant les comportements jugés écologiquement néfastes. Par exemple, les taxes poubelles incitent la population à trier ses déchets, tandis que les taxes sur les carburants la découragent de prendre l’avion ou la voiture et donc d’émettre des gaz à effet de serre. À l’inverse, diverses subventions aux énergies renouvelables et à l’isolation des bâtiments, profitent financièrement aux propriétaires de villas. En matière de politique sociale, les écologistes libéraux dénoncent les distorsions de marché induites par certaines politiques redistributives, notamment celles qui subventionnent les carburants (chauffage, mobilité) pour les plus pauvres. Ils plaident pour réduire les droits sociaux comme le droit à la mobilité au profit d’une tarification effective des déplacements (mobility pricing dans les transports publics), ou pour l’instauration de péages à l’entrée des villes. Cette vision libérale de l’écologie tend ainsi à renforcer les inégalités sociales, dans la mesure où les plus riches sont mieux en mesure de supporter le coût de comportements polluants (p. ex. liés à la mobilité) et sont aussi les bénéficiaires principaux de certaines mesures.
L’écologie sociale lie l’organisation de la société – le capitalisme et la croissance économique perpétuelle – à la dégradation de l’environnement ; elle est formée de deux sous-tendances qui ont des implications différentes en termes de politique sociale. La première sous-tendance – celle de la décroissance – tend à se montrer critique à l’égard de l’industrie, de la technique, et plus généralement de la division du travail et de l’urbanisation. Dans sa filiation avec la tradition libertaire – mais aussi néolibérale – elle identifie la bureaucratie et l’État, comme sources des problèmes. Pour elle, le maintien d’un État social présuppose la perpétuation de la croissance économique destructrice de l’environnement. Prônant l’autogestion, elle critique les politiques sociales et l’État-providence, comme des formes de domination ou de contrôle, rendant les individus dépendants d’une « méga machine » qui restreindrait indûment leur autonomie (Ivan Illich, Lewis Mumford, etc.). Cette tendance de l’écologie est ainsi plutôt opposée aux politiques sociales, si ce n’est la création d’un revenu de base inconditionnel, censé permettre de déconnecter la protection sociale de l’emploi, d’abolir la soi-disant bureaucratie de l’État social et d’augmenter la liberté des individus sur le marché.
Une seconde tendance de l’écologie sociale se montre plus étatiste et avance que les régulations et les politiques publiques sont nécessaires pour créer une économie moins consommatrice de ressources (et plus respectueuse du développement durable), voire pour changer le mode de production (éco-socialisme). Plus proche de la défense traditionnelle de l’État social, cette tendance insiste sur la réduction du temps de travail pour réduire l’impact environnemental de la production et libérer du temps. Elle soutient que la transition écologique à une société moins gourmande en ressources et en énergie, peut créer des emplois et améliorer la qualité de vie. Elle défend l’idée d’une « transition juste » qui implique que les travailleuses et travailleurs des secteurs menacés par les régulations environnementales (mines, énergie, industrie lourde, etc.) ne doivent pas payer la disparition de leur secteur d’activité par la perte de leurs emplois et revenus. Les industriels et l’État doivent compenser les travailleur·euse·s de ces secteurs et leur fournir les moyens (notamment par la formation continue) de se requalifier et de retrouver un emploi dans d’autres secteurs. Les politiques sociales au sens traditionnel ont ainsi une place importante dans cette deuxième tendance de l’écologie sociale, alors que la première préconise leur remplacement par le revenu de base inconditionnel.
Le réchauffement climatique constitue un nouveau défi pour les politiques sociales. Il s’agit d’une part de « décarboniser » l’État social, en réduisant l’empreinte carbone des politiques menées (p. ex. dans les investissements publics dans le logement ou la mobilité), mais aussi de s’assurer que les mesures écologiques (p. ex. la taxation de l’énergie) n’affectent pas disproportionnellement les plus pauvres. Les politiques d’emploi doivent notamment être repensées pour favoriser la réduction collective du temps de travail et sa meilleure répartition, afin de réduire l’empreinte environnementale du mode de production.
Mais l’État social va aussi devoir répondre aux nouveaux risques amenés, ou amplifiés, par les transformations de l’environnement : intempéries, vagues de chaleur, sécheresses, inondations, etc. qui auront des effets sur les conditions de travail, la santé, la disponibilité de la nourriture et de l’eau. Par exemple, en Suisse, les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et longues en été changent les conditions de travail dans le secteur de la construction et nécessitent une nouvelle protection des travailleur·euse·s de ce domaine. Les emplois dans le secteur du tourisme hivernal vont devoir évoluer. Les assurances sociales et les services publics peuvent contribuer à réduire la vulnérabilité des populations aux effets du changement climatique et doivent constituer le cœur des politiques d’adaptation.
Références
Fressoz, J.-B. (2012). L’Apocalypse joyeuse : une histoire du risque technologique. Paris : Seuil.Gough, I. & Meadowcroft, J. (2011). Decarbonizing the welfare state. In J. Dryzek, R.B. Norgaard & D. Schlosberg (Eds.), Oxford handbook of climate change and society (pp. 490-503). Oxford : Oxford University Press.
Koch, M. & Mont, O. (Eds.) (2016). Sustainability and the political economy of welfare. London : Routledge.