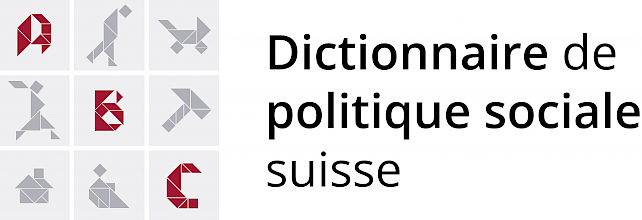Droits des patient·e·s
Dans leur première acception, il s’agit en fait de la mise en œuvre des droits de la personnalité et des droits fondamentaux dans la relation entre patient·e et médecin. D’abord consacrés dans la jurisprudence à partir des années 1970, ils se sont imposés dans les législations cantonales dès le milieu des années 1980. À partir des années 2000, ils apparaissent également en droit fédéral au travers de nombreuses lois spécifiques touchant au progrès médical, comme la loi sur la procréation médicalement assistée, la loi sur la transplantation d’organes, la loi sur l’analyse génétique humaine ou la loi sur la recherche sur les êtres humains. Ils englobent en particulier la règle du consentement éclairé, le droit à l’information, le droit d’accès à son dossier de santé, le droit à la protection de la sphère privée et à la confidentialité, le libre choix de son médecin, le droit d’accès aux soins, le droit au financement des soins essentiels.
Le droit au consentement libre, exprès et éclairé repose sur le principe que chacun dispose d’un droit à l’autodétermination et au respect de son intégrité corporelle. Afin de garantir l’un et l’autre, il est en principe interdit d’imposer un traitement médical ou un soin à une personne contre sa volonté ou simplement à son insu. En fait, juridiquement, chaque acte médical, chaque traitement ou soin implique une atteinte aux droits de la personnalité du patient ou de la patiente concerné·e. En cas d’opération, le chirurgien procède à des gestes invasifs qui sont autant d’atteintes à l’intégrité des patient·e·s. Le simple fait de procéder à une anamnèse en posant des questions sur la santé constitue aussi une brèche dans la sphère privée. Conformément à l’article 28 du Code civil, « une atteinte [aux droits de la personnalité] est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi ». Le consentement du patient ou de la patiente apparaît ainsi comme le motif justificatif de l’acte médical ou du soin. Il s’agit de la pierre angulaire de la relation entre patient·e et personnel soignant.
Pour être valable, le consentement doit être éclairé, autrement dit basé sur des informations claires et compréhensibles de la part des patient·e·s. Cela implique que les patient·e·s soient en mesure de les comprendre et de se prononcer en conséquence. On parle dans ce cas d’un·e patient·e capable de discernement.
La capacité de discernement se comprend comme la faculté d’agir raisonnablement, à savoir la faculté de comprendre les circonstances dans lesquelles on se trouve et celle de pouvoir se décider en conséquence en résistant raisonnablement aux pressions extérieures. En vertu de l’article 16 du Code civil, il existe une présomption de capacité de discernement pour toute personne dont la faculté d’agir raisonnablement n’est pas altérée par une cause prévue par la loi (jeune âge, déficience mentale, troubles psychiques, ivresse ou autres causes semblables). En principe, cette présomption concerne toute personne depuis son adolescence. Le Tribunal fédéral l’a admis pour des patients dès 13 ans. Elle dépend toutefois des circonstances. En l’absence de capacité de discernement, le droit exige que la décision de soins soit prise par une représentation légale ou par les parents lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. En principe, les médecins ne sont autorisé·e·s à agir sans le consentement de la personne ou l’accord de sa représentation légale que dans des situations d’urgence.
Les législations cantonales romandes ont aussi introduit depuis les années 1990 le droit des patient·e·s de rédiger des directives anticipées, à savoir la faculté pour un·e patient·e de définir par écrit le type de traitement qu’elle ou il souhaite recevoir ou non dans l’éventualité où sa capacité de discernement suite à une maladie ou un accident serait perdue. Les directives anticipées permettent aussi de désigner une personne de confiance qui sera chargée de décider en lieu et place de la personne concernée dans de telles circonstances. On parle dans ce cas de « représentant·e thérapeutique ». Depuis la dernière révision du chapitre sur la protection de l’adulte dans le Code civil en 2013, les directives anticipées sont également reconnues en droit fédéral.
Pour que les patient·e·s capables de discernement donnent valablement leur consentement, il convient que ces personnes aient reçu l’ensemble des informations nécessaires afin de se forger une opinion sur les raisons de l’intervention (le diagnostic), l’existence de traitements alternatifs, y compris les conséquences en cas de non-traitement, les bénéfices et les risques associés à chaque traitement possible avec les chances de succès (le pronostic), les contraintes associées à ces traitements (durée, prise de sang, médicaments, hospitalisation, etc.) ainsi que les coûts et leur prise en charge par les assurances. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la patiente ou le patient doit disposer, pour les opérations non-urgentes et électives, d’au moins 72 heures pour se décider entre le moment où l’information est reçue et celui de l’intervention. L’étendue et le degré de précision des informations auxquelles les patient·e·s ont droit dépendent des circonstances. En principe, plus les risques sont élevés, plus le cercle des informations sera large. Il s’agit en fait de garantir que les patient·e·s puissent effectivement exercer leur droit à l’autodétermination et au respect de leur intégrité corporelle en toute connaissance de cause.
Depuis le serment Hippocrate, qui pendant des siècles a servi de fondement à l’éthique médicale, les médecins sont tenu·e·s de garder le secret sur toutes les informations auxquelles le corps médical peut avoir accès concernant les patient·e·s dans l’exercice de sa profession. Le secret médical est consacré en droit suisse à l’article 321 du Code pénal. Sa fonction est double. D’une part, il vise à protéger la sphère privée des patient·e·s en maintenant la plus stricte confidentialité sur les informations les plus intimes qu’une personne peut être amenée à partager avec son ou sa médecin. D’autre part, l’objectif est de garantir le rapport de confiance que les patient·e·s sont en droit d’attendre dans leur relation avec les médecins ou le personnel soignant. Sachant qu’une stricte confidentialité sera maintenue sur les informations confiées au personnel soignant, les patient·e·s seront en confiance pour se dévoiler, condition sine qua non pour poser le diagnostic et définir le traitement adéquat.
Avec l’informatisation de la société dès la fin des années 1980, la capacité de traiter un grand nombre d’informations et de les combiner afin d’établir des profils de personnalité s’est démultipliée. Un tel développement met en cause le fondement même de la sphère privée. C’est ainsi que la Suisse et de nombreux États, notamment en Europe, se sont dotés d’une législation sur la protection des données. Cette loi apporte une protection supplémentaire par rapport au secret médical. Elle ne se limite pas à interdire la divulgation d’informations confidentielles. Elle règle aussi la collecte de ces données qui doit répondre à un but précis avec un intérêt justifié (principe de finalité). De même, l’État ou un organisme privé, comme une assurance complémentaire, ne peut traiter des données sans être autorisé par la loi et avoir le consentement de la personne concernée, le but n’étant pas d’interdire toute utilisation de données, mais d’imposer un usage encadré de celles-ci. De plus, la législation sur la protection des données garantit que chacun puisse savoir quelles informations le ou la concernant sont conservées par qui (principe de transparence). Elle donne aussi un droit d’accès ainsi qu’un droit de demander la correction de ces données, voire leur destruction (droit à l’oubli).
En ce qui concerne le droit d’accès aux soins et à leur financement, il est reconnu par la Constitution fédérale. Sa réalisation dépend toutefois des ressources disponibles et de l’organisation du système de soins. La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) introduit depuis 1996 une obligation à toute personne domiciliée en Suisse d’être assurée contre les aléas de la maladie afin de couvrir les frais. L’objectif est de permettre à chacun d’accéder à des soins essentiels, en principe sans devoir se préoccuper des coûts. Pour les personnes à revenu modeste, il existe un mécanisme de subvention qui permet de couvrir tout ou partie de leurs primes d’assurances. Au-delà de sa dimension sociale indéniable, l’accès aux soins en Suisse est plutôt satisfaisant en comparaison internationale, l’objectif de contrôle des coûts de la LAMal n’a toutefois pas été atteint et les primes ne cessent d’augmenter. Cela grève de manière toujours plus importante le budget des ménages, surtout de la classe moyenne.
Références
Manaï, D. (2013). Droits du patient face à la biomédecine (2e éd.). Berne : Stämpfli.Services de la santé publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud (2014). L’essentiel sur les droits des patients (3e éd.). [multiples lieux] : [multiples éditeurs].