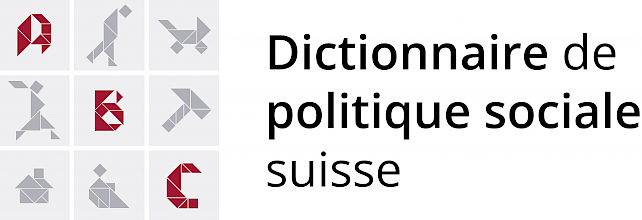Divorce
L’imbrication du système de genre, du patriarcat et du capitalisme fait que le divorce ou la séparation, lorsqu’il y a des enfants, devient une étape risquée de la vie familiale, en termes économiques et sociaux, quel que soit le statut des personnes concernées (époux ou épouse, enfant, père, mère ou parent social). La division sexuée du travail (séparation et hiérarchisation des activités masculines et féminines, ségrégation entre la sphère productive et reproductive) et le régime de genre en vigueur (naturalisation des rôles parentaux, assignation des femmes aux soins des proches) pèsent sur les processus de séparation, la famille restant associée à la gratuité et ne donnant que peu de rétributions s’agissant des droits sociaux.
Les politiques encadrant le divorce ne prennent pas en compte les inégalités de genre et de statut en matière d’assistance aux enfants. De ce fait, elles ne parviennent pas à compenser la « charge mentale » et matérielle que représente l’éducation d’un enfant lorsque les parents sont séparés. Elles restent plutôt paternalistes, voire patriarcales, s’adaptent trop lentement aux mutations familiales et sont incapables d’en limiter les coûts spécifiques pour certaines populations, alors même que l’objectif de justice sociale est au cœur de leur développement.
Des changements législatifs notables sont pourtant à signaler. En 2000, la loi fédérale consacre le divorce par consentement mutuel, la possibilité d’une autorité parentale conjointe et la reconnaissance partielle du travail ménager effectué par les femmes par le partage du 2e pilier notamment. En 2014, plus tard que dans les autres pays européens, l’autorité parentale conjointe devient la modalité ordinaire du « départage de l’enfant ». Les négociations ont été ardues, car des voix, notamment celles des féministes, se sont élevées, afin que soient liées la question de l’autorité parentale et celle de l’entretien de l’enfant. Elles n’ont pas été entendues et un certain nombre de questions restent ouvertes en lien avec la résidence de l’enfant.
La sous-estimation du care pénalise les personnes qui le produisent et les enfants. De ce fait, près de la moitié des enfants recevant l’aide sociale vivent dans des foyers monoparentaux. Les lois visant une meilleure répartition des charges, le partage du deuxième pilier par exemple, ne sont qu’imparfaitement appliquées. Les contributions d’entretien destinées aux enfants, payées irrégulièrement dans 20 % des cas et inférieures aux coûts effectifs des enfants, créent des injustices entre les familles des classes populaires et celles des milieux aisés : il est beaucoup plus pénalisant financièrement pour un père au revenu modeste de payer une pension, si modique soit-elle, que pour un père directeur de banque. Les pratiques de recouvrement et d’avance de pension, dépendantes de l’action des bénéficiaires, contribuent toujours et encore à l’accroissement des inégalités entre les familles. En fait, les politiques sociales ne répondent pas au risque économique encouru parce qu’elles se confinent au registre assistanciel et à celui de la subsidiarité : l’aide sociale est accordée sous « condition de ressources » et remboursable lorsqu’on revient à meilleure fortune ; l’aide au recouvrement, suivant des règles fluctuantes, n’est disponible qu’aux plus pauvres.
Si l’autorité conjointe et la garde partagée marquent symboliquement une place équivalente des deux parents, elles ne sont pas synonymes d’égalité et peuvent être le lieu d’une démonstration de puissance et un moyen de pression supplémentaire pour les parents, puisque chaque décision importante peut être négociée et refusée par la partie adverse, contrevenant ainsi à l’idéal de coparentalité souhaité par la loi. Sans garde-fous et sans contrôles, elles pourraient, d’une part, légitimer le paiement de pensions très basses par les individus bénéficiant d’un revenu supérieur grâce à leur inscription en continu et à plein temps dans le travail salarié. Et d’autre part, elles ne les empêcheraient pas de déléguer à d’autres personnes une partie des tâches éducatives qui leur échoient en tant que coresponsables de l’enfant. Les quelques interventions sociales cherchant à réduire ces tensions, telle la médiation familiale, ne sont pas pensées dans une perspective de rapports sociaux potentiellement conflictuels et peuvent apparaître comme une imposition faite aux personnes dominées. Par ailleurs, dans les cas de violences conjugales, très peu de mesures permettent de protéger l’enfant.
Une part des professionnel·le·s de l’accompagnement social mobilisent des définitions normatives de ce que devrait être une famille ainsi que des visions passablement négatives des parents séparés. Si le stigmate s’est estompé du fait de la banalisation du divorce, les foyers monoparentaux, dont plus de 80 % ont une femme à leur tête, sont de manière générale plus soumis à l’examen. Le nombre d’enfants institutionnalisé·e·s issu·e·s de ce type de ménage, environ 70 % de la population accueillie, en témoigne. De plus, les structures de garde censées soulager les parents sont insuffisantes, chères et peu flexibles face aux situations de l’après-divorce : il est compliqué de changer le jour où l’enfant est accueilli ; un foyer monoparental ou une garde partagée n’octroient pas de priorité pour l’obtention d’une place en garderie. Cette quasi absence de politiques substitutives orientées vers un traitement égalitaire entre les enfants, un dépassement des codes de genre et une interchangeabilité des rôles des parents complexifie l’organisation quotidienne des mères et des pères, même s’ils sont coopérants, et engendre une forme de fragilisation parentale, doublée d’une discrimination potentielle principalement pour les familles en difficulté.
Considérer le divorce comme un risque social requiert d’imaginer un mode collectif et réellement égalitaire de traiter cet événement probable pour une grande partie de la population. Le traitement devrait alors s’émanciper des pièges de genre. Il chercherait à diminuer les inégalités structurelles en élevant globalement les salaires dans les branches féminisées de l’économie et en offrant une juste rémunération du care effectué par les personnes qui sont pourvoyeuses de soin et productrices de travail domestique. Il pourrait comprendre une assurance-divorce, avec retenue automatique sur le salaire du débiteur, inspirée de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Un revenu minimum de base pour chaque enfant serait aussi à envisager. Il tendrait à redistribuer les responsabilités « du faire famille » et à contrer la réification des rôles familiaux en fonction du sexe par la mise en place de divers soutiens sociaux (formation des professionnel·le·s, garderie, activités culturelles, etc.).
Références
Freivogel, E. (2007). Contribution d’entretien après le divorce : soutien financier par des proches parents. Aide sociale. Questions au féminin, 1, 25-38.Palazzo-Crettol, C. (2014). Du bien-être des enfants et des politiques sociales : des enjeux contradictoires. Dans P. Jaffé (Éd.), Enfants, familles, État : les droits de l’enfant en péril (pp. 60-68). Sion : Institut universitaire Kurt Bösch.
Stutz, H., Knupfer, C. & Thomet, U. (2012). La protection sociale du travail de care non rémunéré : les besoins d’adaptation de l’État social liés à l’évolution du partage du travail entre femmes et hommes. Berne : Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes.