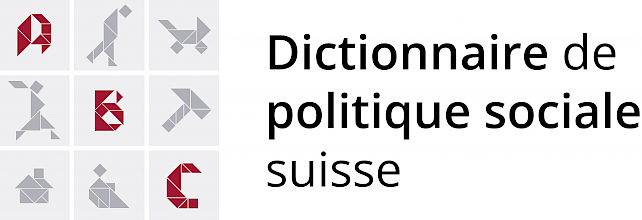Travail social (histoire)
Version originale en allemand
D’un point de vue historique, le champ d’action du travail social est caractérisé par ce rapport tendu entre aide et contrôle. En Suisse, jusqu’aux bouleversements de 1968, le travail social accordait généralement plus de poids au mandat institutionnel qu’à l’objectif d’autodétermination des client·e·s. Ce fut le cas tout spécialement pour l’aide aux pauvres, l’éducation en foyer et le système des tutelles, domaines situés dans un contexte de contrainte, réglementé par la loi. Un travail social critique, politiquement engagé, soucieux de faire pencher les conditions-cadre sociétales vers une plus grande justice sociale, était alors marginal en Suisse, et donc marginale aussi l’idée d’une relation à pied d’égalité entre travailleur·euse·s sociaux·ales et personnes concernées.
Le thème de la relation entre les personnes qui donnent et celles qui reçoivent a une longue tradition. Au Moyen-Âge, l’assistance relève de l’église et des évêques. Les hôpitaux et les hospices bénéficient de donations et de legs de fidèles qui, à l’occasion de leurs funérailles ou de messes d’anniversaires, font distribuer de l’argent aux pauvres. Thomas d’Aquin (1224-1274) est le plus célèbre représentant d’une théorie théologique de l’assistance. Pour lui, l’amour du prochain et l’aumône sont des préceptes religieux et un devoir moral contraignants. Le mouvement piétiste du XIXe siècle, arguant lui aussi de l’amour du prochain, prône une intériorisation individuelle de la vie chrétienne et tire de cette conviction religieuse des principes éducatifs qu’il met en œuvre dans des asiles.
Des philanthropes de la veine d’un Henri Pestalozzi, ancrés dans la tradition des Lumières, appellent, eux, à une réforme de la société par l’éducation. Ils sont généralement issus de la bourgeoisie détentrice de biens et savante, produits de l’industrialisation. Le grand nombre de sociétés fondées à cette époque reflète l’importance de la philanthropie au XIXe siècle. Mentionnons la Société suisse d’utilité publique, fondée en 1810 à Zurich dans le but de promouvoir le bien commun spirituel et matériel, et la Société d’utilité publique des femmes suisses, créée en 1888. Au niveau local, des sociétés de secours et des associations de femmes s’attaquent à ce qu’elles appellent la « question sociale », à savoir les problèmes de la classe ouvrière générés par l’industrialisation fulgurante. Les associations de femmes bourgeoises défendent une répartition traditionnelle des rôles – l’homme au travail, la femme au foyer – dans une action philanthropique à caractère moralisateur.
Sur toile de fond de l’idéal bourgeois de la distribution des rôles entre femmes et hommes, les premières travailleuses sociales après 1900 donnent une nouvelle clé de lecture de l’assistance avec l’idée de la « maternité sociale ». Les femmes, tel leur argument, sont empathiques de nature et donc bien disposées envers autrui. À cette idée de « maternité sociale », elles associent une stratégie d’émancipation. L’effet est ambivalent : si des femmes bourgeoises célibataires peuvent désormais exercer une activité professionnelle, leur champ d’action demeure limité à des domaines réputés correspondre à leur nature de femme, comme la protection de l’enfance. Les postes prestigieux et mieux payés, par exemple celui de secrétaire de la jeunesse ou de tuteur officiel, sont réservés à des juristes masculins, alors que les premières travailleuses sociales occupent des emplois subalternes. En outre, l’attachement à la représentation bourgeoise des rôles masculin et féminin a des effets normatifs sur les client·e·s, du fait que les mères ouvrières et les pères ouvriers de la classe inférieure ne peuvent ou ne veulent pas correspondre aux impératifs comportementaux liés au modèle de l’homme nourricier et de la femme au foyer. Les femmes bourgeoises ne sont guère capables, à l’époque, de réagir aux réalités des personnes concernées avec des méthodes professionnelles adéquates et se rabattent sur leurs valeurs morales dans le traitement des cas sociaux.
Par voie de conséquence, la génération de savoir dans le travail social en Suisse en est restée à un stade préscientifique jusque dans un XXe siècle bien avancé. La pratique demeure empreinte de paternalisme et centré sur le contrôle de comportement des clients. Dans les écoles de travail social aussi, la proximité à la pratique est, au début, davantage considérée que le savoir théorique. Ajoutons à cela que les travailleuses et travailleurs sociaux·ales ne participent guère aux débats de fond menés lors de congrès de politique sociale et relayés dans la presse spécialisée – la parole est aux juristes, aux médecins et aux pédagogues.
Après 1945, la conviction fait son chemin dans les pays d’Europe occidentale que l’État social doit jouer un rôle de pacificateur. On problématise la mainmise disciplinaire sur les clients. En postulant le respect de la dignité humaine dans le domaine du travail social, l’ONU lance une réflexion sur des interventions fondées sur la théorie et sur des valeurs éthiques. Dans le cadre de cette réflexion, la méthode du casework, développée aux États-Unis par Mary Richmond, est progressivement adoptée en Suisse. Le casework réforme l’aide individuelle classique en combinant le processus d’évaluation avec un plan d’intervention conçu, dans l’idéal, en collaboration avec les client·e·s. Pour la première fois, des représentantes des écoles de travail social participent à des débats sur la politique sociale.
Depuis les années 1960, la formation et la pratique dans le domaine du travail social adoptent de manière accrue des éléments du travail communautaire, avec un accent fort sur l’intégration culturelle – méthodes prônées et pratiquées des décennies auparavant déjà dans l’espace anglophone, notamment dans le settlement movement. Plus récemment, l’activité de conseil a augmenté dans de nouveaux lieux d’intervention, par exemple l’école. L’autocompréhension du travail social a également changé : d’abord compris comme expression de l’amour du prochain, puis au sens de la maternité sociale, le travail social se charge bientôt d’une fonction normalisante, fonction qu’il cherche à dépasser depuis les années 1980 en axant ses interventions sur les réalités, les droits de la personne et les droits sociaux, au travers de théories d’émancipation.
Références
Hering, S. & Waaldijk, B. (Eds.) (2003). History of social work in Europe (1900-1960) : female pioneers and their influence on the development of international social organizations. Opladen : Leske + Budrich.Matter, S. (2011). Der Armut auf den Leib rücken : Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz, 1900-1960. Zürich : Chronos.